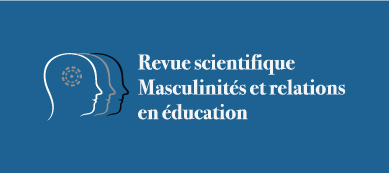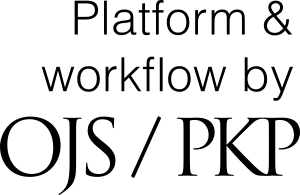Appel à textes
Chères autrices, chers auteurs,
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la revue Masculinités et relations en éducation. Cette dernière traite de la question des masculinités à travers le prisme de ses différentes identités et expressions en éducation. La présente revue se consacre également aux relations que nouent les divers acteurs scolaires masculins en éducation.
Alors que l’on assiste à une redéfinition progressive et plus saine des rôles sociaux associés à la masculinité (participation parentale plus marquée des pères dans l’éducation des enfants, partage plus équilibré dans les responsabilités domestiques et familiales, prise du congé parental par les pères (Devault et Devault-Tousignant, 2022; Villeneuve et Dubeau, 2022)), les jeunes demeurent encore aujourd’hui exposés à certaines normes négatives de la masculinité traditionnelle (ou hégémonique) à travers les réseaux sociaux, telles que la dévalorisation des femmes et le pouvoir exercé à leur endroit en matière de sexualité ou d’autonomie économique de même que la relation distante et autoritaire engagée avec les enfants (Delaquis, 2015; Pacouret, Bastin et Marty, 2024). De même, les hommes qui n’adoptent pas, qui ne se conforment pas ou qui ne correspondent pas à ces normes sont considérés inférieurs et, du même coup, leur forme de masculinité se voit invalidée (p. ex., discrimination, ostracisation, homophobie) (Connell, 2005). Les normes négatives de la masculinité, si elles sont internalisées par les jeunes garçons, seraient ainsi préjudiciables pour les femmes et pour les enfants. Dans cette conjecture, il apparaît important que les garçons côtoient des modèles positifs d’hommes promouvant des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes et des attitudes d’inclusion.
Cela dit, nous remarquons un faible effectif d’hommes en enseignement primaire dans plusieurs pays, notamment le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie, pour incarner cette évolution positive en termes de normes sociales de la masculinité. Par exemple, au Québec, environ 36,0 % des membres du personnel en enseignement secondaire étaient des hommes en 2020-2021 (ministère de l’Éducation du Québec [MEQ], 2022). Pour la même période, en enseignement primaire, on observe que les hommes représentent seulement autour de 16,0 % du personnel enseignant (ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur [MEES], 2022). Cette présence moins marquée des hommes en éducation s’expliquerait, entre autres, par la perpétuation de certains stéréotypes voulant que les femmes soient naturellement disposées à prendre soin des enfants en raison de leur capacité à enfanter. Cette vision essentialiste aurait le potentiel de restreindre certains hommes à s’engager dans un parcours d’études universitaires dans le domaine de l’éducation et, ultimement, à entreprendre une carrière comme enseignants par crainte d’être étiquetés comme féminins, homosexuels ou prédateurs d’enfants (Beaudoin, 2021; Cushman, 2005; Mistry et Sood, 2016).
Parallèlement, les résultats de quelques études mettent en évidence l’importance des modèles masculins à l’école auxquels les élèves, autant garçons que filles, peuvent se référer dans la construction de leur identité (égalité homme-femme, partage équilibré des rôles parentaux (McGrath et Sinclair, 2013)). À ce sujet, une présence plus notable d’hommes en enseignement préscolaire et primaire concourrait à promouvoir davantage de modèles de masculinités saines auprès des garçons, faisant ainsi obstacle aux normes négatives de la masculinité traditionnelle (hégémonique) (p. ex., valorisation du patriarcat et de l’hétéronormativité, domination des femmes par les hommes) (Connell, 2005) auxquels adhèrent encore certains hommes. De fait, encore faut- il que ces enseignants valorisent des masculinités saines et établissent une relation positive et proximale avec les garçons pour que ces derniers puissent accueillir et adopter plus aisément des pratiques sociales positives comme hommes.
À ce sujet, il ressort qu’une relation enseignant-élève (REÉ) de qualité, que nous qualifions également de positive, est susceptible de soutenir les élèves, qu’ils soient filles ou garçons, à la fois sur les plans affectif, social et scolaire (Beaudoin, 2021; Beaudoin, 2022), contribuant possiblement à une meilleure régulation comportementale. De fait, l’établissement d’une REÉ positive est lié à l’engagement scolaire des élèves (Danielsen et al., 2010) et à l’amélioration de leurs comportements en classe (Mertika et al., 2020). Mentionnons qu’une REÉ positive a des effets encore plus bénéfiques auprès des élèves rencontrant des difficultés comportementales (ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche [MEESR], 2015). À l’opposé, la présence d’une REÉ négative accentue le stress chez les élèves (Putwain et al., 2016) et a un effet négatif sur leur motivation et leur engagement scolaires (De Meyer et al., 2014). D’ailleurs, on observe que les garçons entretiennent généralement des relations plus conflictuelles et distantes que les filles avec le personnel enseignant (Jerome et al., 2009). De leur côté, tant les enseignants que les enseignantes décrivent leurs relations avec les garçons comme étant plus conflictuelles qu’avec les filles (Spilt et al., 2012). En effet, les garçons sont plus portés à manifester de mauvais comportements en classe comparativement aux filles (Clark et al., 2008). Il est également connu que les élèves qui ont des interactions négatives avec le personnel enseignant ont tendance à manifester plus de comportements agressifs à son endroit comme pousser ou donner des coups (De Laet et al., 2016).
Tenant compte de ce contexte, nous invitons les autrices et les auteurs à soumettre des contributions originales et novatrices qui tendent à répondre aux questions suivantes :
-
Comment se nouent les relations entre les enseignants hommes et les élèves garçons en éducation? Pourquoi et comment dénouer ces relations ou les transformer en fin de parcours scolaire?
-
Quels sont les mécanismes individuels et sociaux qui interagissent dans l’établissement d’une relation entre les enseignants hommes et les élèves garçons?
-
Quels sont les bienfaits associés à une relation de qualité établie entre les enseignants hommes et les élèves garçons?
-
Quels sont les limites et les obstacles (p. ex., politiques, sociologiques, psychologiques) qui nuisent au développement d’une relation de qualité entre les enseignants hommes et les garçons?
Les textes soumis sont appuyés par la documentation empirique, qu’elle soit professionnelle ou scientifique. Ils présentent un argumentaire nuancé et critique sur les enjeux relatifs aux masculinités et aux relations en éducation.
Tous les articles seront soumis à un processus d'évaluation par les pairs pour garantir la qualité et la pertinence des publications.
Si vous souhaitez contribuer à ce numéro, nous vous invitons à soumettre un bref résumé de votre article (300-500 mots) avant le 31 octobre 2024.
Suivant l’acceptation de votre proposition de texte par le comité de rédaction, la version finale de votre article est attendue avant le 15 janvier 2025.
Nous sommes impatients de recevoir vos contributions pour enrichir la compréhension des masculinités et des relations en éducation.
Pour toute question ou demande d'information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter le Laboratoire international de recherche et d’expertise sur les relations éducatives et les masculinités en contextes éducatifs (LIRE-RÉMCÉ) à l’adresse suivante : lireremce@uqtr.ca
Cordialement,
Carl Beaudoin, rédacteur en chef
Université du Québec à Trois-Rivières, Canada
Comité de rédaction
Mhamed Alouiz, Université Cardi Ayyad, Maroc
Samia Berrada, Université Cardi Ayyad, Maroc Hasheem Hakeem, Northwestern University, États-Unis Kevin Péloquin, Université de Montréal, Canada
Comité étudiant de rédaction
Moussa I Camara, Université Nelson Mandela, Guinée
Annie Chiasson, Université du Québec à Trois-Rivières, Canada
Emmanuel Lorvinsky Pluviose, Université Publique du Nord au Cap-Haitien, Haïti Frédéric Martin, Université du Québec à Trois-Rivières, Canada
Anderson Pierre, Université d’État d’Haïti, Haïti
Hanane Zaafrani, Université Cadi Ayyad, Maroc
Références
Beaudoin, C. (2021). Perceptions des enseignants et des garçons à l’égard de la relation enseignant- élève au secondaire : quand les stéréotypes de genre s’immiscent en classe. Revue canadienne de l'éducation, 44(3), 848–874.
Beaudoin, C. (2022). La relation enseignant-élève. Perspectives affective, humaniste, cognitive et sociale. Presses de l’Université du Québec.
Clark, M. A., Thompson, P. et Vialle, W. (2008). Examining the gender gap in educational outcomes in public education: Involving pre-service school counsellors and teachers in cross-cultural and interdisciplinary research. International Journal for the Advancement of Counselling, 30(1), 52-66.
Connell, R. W. (2005). Masculinities. Routledge.
Cushman, P. (2005). Let's hear it from the males: Issues facing male primary school teachers,
Teaching and Teacher Education, 21(3), 227-240.
De Laet, S., Colpin, H., Van Leeuwen, K., Van den Noortgate, W., Claes, S., Janssens, A.,
Goossens, L. et Verschueren, K. (2016). Teacher-student relationships and adolescent behavioral engagement and rule-breaking behavior: The moderating role of dopaminergic genes. Journal of of School Psychology, 56, 13-25.
De Meyer, J., Tallir, I. B., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Aelterman, N., Van den Berghe, L., Speleers, L. et Haerens, L. (2014). Does observed controlling teaching behavior relate to students’ motivation in physical education. Journal of Educational Psychology, 106(2), 541- 554.
Jerome, E. M., Hamre, B. K. et Pianta, R. C. (2009). Teacher-child relationships from kindergarten to sixth grade: Early childhood predictors of teacher-perceived conflict and closeness. Social Development, 18(4), 915-945.
McGrath, K. et Sinclair, M. (2013). More male primary-school teachers? Social benefits for boys and girls. Gender and Education, 25(5), 531–547.
Mertika, A., Mitskidou, P. et Stalikas, A. (2020). “Positive Relationships” and their impact on wellbeing: A review of current literature. Psychology: the Journal of the Hellenic Psychological Society, 25(1), 115–127.
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche [MEESR] (2015). Cadre de référence et guide à l’intention du milieu scolaire. L’intervention auprès des élèves ayant des difficultés de comportement. Gouvernement du Québec.
Mistry, M. et Sood, K. (2016) Busting the myth of gender bias: views from men and women primary-school trainees and teachers. Education 3-13, 44(3), 283-296.
Pacouret, J., Bastin, G. et Marty, E. (2024). L’espace social des réseaux sociaux Une approche relationnelle de l’usage des plateformes numériques en France. Sociologie, 15(2), 119-146.
Putwain, D., Remedios, R. et Symes, W. (2016). The appraisal of fear appeals as threatening or challenging: Frequency of use, academic self-efficacy and subjective value. Educational Psychology, 36(9), 1670–1690.
Spilt, J. L., Koomen, H. M. Y. et Jak, S. (2012). Are boys better off with male and girls with female teachers? A multilevel investigation of measurement invariance and gender match in teacher–student relationship quality. Journal of School Psychology, 50(3), 363-378.